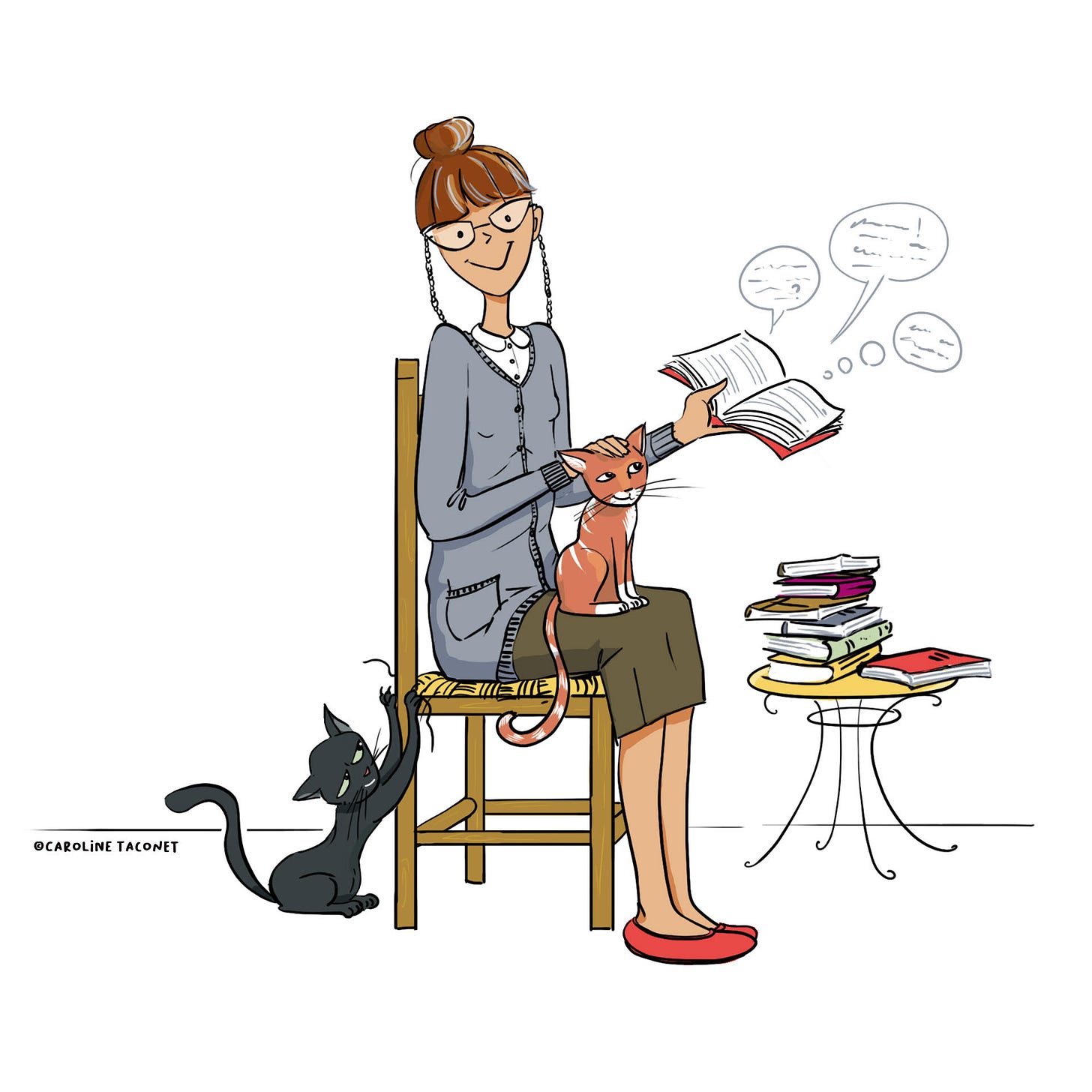Si les hommes lisaient comme les vieilles, le monde irait mieux
Article VEP #2
Il y a un an, la saison 1 de Vieilles en puissance s’achevait, après de riches échanges sur les femmes, l’âge et l’argent.
En attendant une éventuelle saison 2, nous poursuivons l’aventure sous une autre forme : une série d’articles publiés tous les quinze jours sur vieillesenpuissance.com, autour de nos thèmes de prédilection — argent, âgisme, travail, culture et art.
Caroline & Laetitia
On dit souvent que la société repose sur les épaules des femmes, avec tout le travail gratuit de soin aux autres qu’elles assurent quotidiennement. Et c’est vrai que le foyer, les enfants et les malades passeraient un mauvais moment si les femmes faisaient soudain la grève. Mais ce qui est vrai du soin des corps et des âmes est vrai aussi du soin des arts, des mots et de la mémoire collective. Le monde des livres, lui aussi, repose sur les femmes — et tout particulièrement sur les vieilles. Ce sont elles qui lisent, qui achètent, qui commentent, qui transmettent. Elles soutiennent, presque à elles seules, une industrie culturelle toute entière.
Bien sûr, toutes les vieilles ne lisent pas. Mais parmi les lecteurs, elles sont très surreprésentées. Elles lisent tout — des romans contemporains, des classiques, des polars, de la littérature étrangère. Elles sont la colonne vertébrale du monde littéraire. Or on parle rarement d’elles. On célèbre les auteurs, souvent masculins, les jeunes plumes prometteuses, les grandes idées, mais on oublie les vieilles qui tournent les pages, semaine après semaine.
Si les hommes lisaient comme les vieilles — avec la même curiosité, la même attention, la même ouverture à la complexité humaine — le monde s’en porterait sans doute mieux. Car lire n’est pas seulement un loisir : c’est un acte de civilisation.
Les vieilles font vivre la littérature
En France, la lecture est d’abord une affaire de femmes. Selon une étude du Centre national du livre (CNL, 2021), 88 % des femmes se déclarent lectrices, contre 77 % des hommes. L’écart devient gigantesque lorsqu’il s’agit de fiction : 67 % des femmes lisent des romans, contre seulement 42 % des hommes. Les femmes de plus de 50 ans sont la catégorie la plus assidue. Elles empruntent à la bibliothèque, achètent en librairie, échangent des livres… En Europe, les femmes lisent plus que les hommes. Une fois les études terminées (quand on « doit » lire des livres), elles sont plus nombreuses à poursuivre la lecture par plaisir.
Les 50 ans et plus représentent une part importante des achats de livres même si la ventilation exacte par sexe et par âge n’est pas évidente à trouver. Tout le monde le sait pourtant : les maisons d’édition, les libraires, les auteurs et les bibliothécaires savent bien que les vieilles comptent. Mais trouver des statistiques qui croisent âge et genre relève de la croix et de la bannière. Preuve, encore une fois, que les vieilles restent invisibilisées, même là où elles sont omniprésentes.
Elles ne se contentent pas de lire, elles font vivre la littérature. Elles en sont les gardiennes et les passeuses. Elles discutent des livres, les prêtent, les recommandent, les font exister dans la conversation. Elles nourrissent les clubs de lecture, les cercles de bibliothèques, les forums, les festivals. Sans elles, il n’y aurait pas de bouche-à-oreille, pas de longue traîne pour les romans qui échappent aux grandes campagnes marketing. Elles sont aussi de plus en plus nombreuses à écrire de la fiction. En somme, elles incarnent la mémoire collective. À travers les livres, elles maintiennent le lien entre les générations, entre les morts et les vivants, entre l’intime et le politique. Lire et écrire, pour beaucoup d’entre elles, c’est une forme de soin du monde.
Qui écrit, qui est lu ?
Dans un article du New York Times, l’écrivain David J. Morris s’inquiète de la « disparition des hommes littéraires », ces lecteurs et auteurs de fiction qui se raréfient. Les jeunes hommes lisent de moins en moins de romans, se détournent de la fiction au profit d’autres formes de divertissement ou de discours (podcasts, vidéos, jeux en ligne), et semblent se couper du pouvoir transformateur du récit. La littérature devient ainsi, selon Morris, un territoire presque exclusivement féminin — écrit, publié et lu par des femmes. Or, comme il le rappelle, « le destin de la littérature et celui de la société sont liés » : quand la moitié de l’humanité se désintéresse du roman, c’est tout un imaginaire commun qui s’appauvrit.
Pourtant, les femmes restent sous-représentées là où il y a du prestige. En France, selon l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture, seulement 37 % des romans publiés en 2022 étaient signés par des autrices, et les prix littéraires continuent d’être majoritairement attribués à des hommes, malgré une légère progression (38 % des auteurs sélectionnés et 39 % des lauréats entre 2012 et 2021). Il existe un important décalage entre la consommation, la production littéraire et la visibilité des autrices.
Les femmes lisent des auteurs masculins et féminins, tandis que les hommes lisent majoritairement des auteurs masculins, une tendance confirmée au Royaume-Uni et aux États-Unis : parmi les dix autrices les plus vendues au Royaume-Uni, 81 % des lecteurs sont des femmes et seulement 19 % des hommes, alors que la répartition pour les auteurs masculins est beaucoup plus équilibrée. Aux États-Unis, en 2022, seulement 27,7 % des hommes adultes ont lu un roman ou une nouvelle, contre 46,9 % des femmes.
Ce désintérêt des hommes a des conséquences concrètes sur la reconnaissance des autrices. Les livres écrits par des femmes restent moins valorisés : en Amérique du Nord, ils sont en moyenne vendus 45 % moins cher. Cette disparité s’étend aux critiques et aux jurys : majoritairement masculins, ils ont tendance à accorder plus de visibilité et de prestige aux œuvres d’hommes, contribuant à renforcer l’idée que la littérature « sérieuse » est masculine. Mary Ann Sieghart souligne que les hommes sont moins exposés aux voix féminines. Cette asymétrie en dit long. Lire un roman écrit par quelqu’un d’un autre sexe, d’une autre époque, d’un autre monde, c’est déjà faire l’expérience d’une altérité. C’est entrer dans un imaginaire qui n’est pas le sien. Les femmes le font quotidiennement. Les hommes, beaucoup moins.
Si les hommes lisaient comme les vieilles, le monde s’en porterait mieux
Dans un article de The Atlantic intitulé “The Real Reason Men Should Read Fiction”, le journaliste s’interroge sur le déclin de la lecture au masculin. La fiction leur paraît inutile ou « féminine ». Pourtant, lire de la littérature, c’est une manière de se retirer du bruit ambiant pour explorer d’autres consciences. Lire, c’est s’échapper de soi-même. Dans un monde saturé d’opinions et de certitudes, la lecture romanesque offre un espace de complexité. Elle nous apprend à vivre avec l’ambiguïté, à comprendre les motivations contradictoires des personnages, à suspendre le jugement. Bref, à exercer cette forme de pensée lente dont notre époque manque cruellement.
Peut-être que si les hommes lisaient davantage de fiction, ils seraient moins tentés par les simplifications de la colère, moins vulnérables aux discours de ressentiment. Peut-être que la fiction, justement parce qu’elle ne donne pas de leçons, nous apprend à vivre avec la nuance.
Il faudrait réhabiliter la figure de la vieille lectrice, comme modèle d’attention et d’ouverture. Lire comme elles, c’est accepter la complexité et l’altérité. Si les hommes lisaient comme elles, le monde s’en porterait mieux : plus de nuances, moins d’agressivité ; plus d’attention, moins de certitudes.